La période de l’après-guerre fut une période paradoxale. D’un côté, la CTCC s’affirme de plus en plus radicale jusqu’à sa transformation en CSN et la syndicalisation du secteur public. De l’autre, le conseil central de Québec apparaît singulièrement prudent et attaché aux traditions.
Par Nicolas Lefebvre Legault, Conseiller à l’information
Un conseil central… prudent

L’exécutif du Conseil central des syndicats catholiques de Québec élu au congrès de 1960.
Dans un reportage publié dans Le Devoir, à l’occasion du congrès de 1954 du conseil central, le journaliste Fernand Dansereau parle pudiquement « d’un esprit plus prudent » des syndicats de Québec. Il s’agit en fait d’un euphémisme pour ne pas dire que le conseil central est à l’époque réputé plutôt conservateur et attaché aux traditions.
Alors que la direction de la CTCC est engagée à fond dans la lutte contre Duplessis et qu’elle flirte ouvertement avec certains partis, le conseil central est allergique à l’action politique. Mais vraiment allergique! Au point de boycotter la « Marche sur Québec » de 1954, la première manifestation intersyndicale de l’histoire à se tenir dans la capitale, parce qu’elle est considérée comme trop partisane.
Dans la longue marche de la CTCC, puis de la CSN vers l’action politique non partisane, le conseil central résiste à toutes les étapes. Ainsi, lorsque le congrès de 1954 de la CTCC vote en faveur de l’action politique syndicale, le conseil central répond en formant un « comité d’action civique » de cinq membres dont le mandat est de présenter un mémoire par année à la ville et à la commission scolaire. En 1959, alors que la centrale débat de la possibilité de participer à la fondation de ce qui deviendra le NPD, le conseil central soumet un amendement à la constitution pour préciser qu’« il est interdit à tout officier et permanent de la CTCC et de ses corps affiliés de s’afficher publiquement en faveur d’un parti politique quelconque ».
Éducation syndicale
Par contre, le conseil central est reconnu pour faire de l’éducation syndicale une priorité. Cela se traduit par des cercles d’étude, de très nombreuses journées d’étude, un collège ouvrier ainsi que des tournées d’assemblées et de formation. Dès 1953, le conseil central embauche un permanent, Réal Label, spécifiquement pour s’occuper d’éducation. Il sera appuyé, à partir de 1957, par un journaliste, Joseph Pelchat, que le conseil central embauche pour faire la promotion du syndicalisme, notamment au moyen de causeries tous les dimanches à la radio et d’une page hebdomadaire dans l’Action catholique.
Organisation
En l’espace de vingt ans, de 1942 à 1962, le membership du conseil central augmentera de 75 %, passant le cap des 20 000 membres. Cette augmentation du membership amènera le conseil central à se professionnaliser. En 1951, l’assemblée générale décide de doubler la cotisation afin d’embaucher deux fois plus d’organisateurs (on passe de deux à quatre). Pour appuyer les syndicats non fédérés, un conseiller technique et deux agents d’affaires s’ajoutent bientôt à l’équipe.
En juin 1952, lors d’une journée d’étude, à laquelle participent une centaine de syndicalistes, on propose des changements à l’organisation du conseil central. On suggère d’introduire un congrès annuel, de passer à une assemblée générale par mois (plutôt que deux), de se doter d’un budget annuel et d’embaucher une secrétaire. Le reste de la structure change peu, le conseil central est toujours dirigé par un comité exécutif d’une quinzaine de membres et un comité de régie d’une demi-douzaine d’élus. Les équipes sont alors relativement stables (sur 25 ans, on compte six présidents, dont deux, Joseph Parent et Roland Tapin, qui ont fait des mandats de huit ans).
Bouleversements
La croissance du membership est d’autant plus phénoménale que le territoire du conseil central rapetisse au fur et à mesure que la CTCC se développe. En effet, les syndicats du Bas-Saint-Laurent quittent en 1945 pour former le conseil central de Rimouski, ceux de Thetford Mines feront de même en 1957. Un peu plus tard, ce seront les syndicats de Plessisville qui se joindront au conseil central de Victoriaville. Finalement, en 1960, le conseil central devra expulser « à regret » les syndicats de fonctionnaires municipaux puisque leur fédération a décidé de faire bande à part (c’est l’ancêtre de la FISA).
En 1962, après des années de débats, la CSN procède à une réforme de structures et crée des bureaux régionaux. Ces bureaux, sous couvert d’uniformiser les services aux syndicats, prennent sous leur aile tous les permanents des conseils centraux et presque tous leurs champs d’action. Le conseil central est définitivement évacué du champ de la négociation, perd la conduite des grèves et n’est plus que partie prenante de l’élaboration des politiques en matière d’organisation et d’éducation. Il ne reste plus, en fait, que la représentation politique auprès des villes, des commissions scolaires et des groupes sociaux. En 1964, c’est la fin d’une époque, le siège social de la centrale déménage à Montréal.
Un nouvel édifice
C’est en 1951 qu’est inauguré le nouvel édifice du Secrétariat des syndicats catholiques de Québec (l’actuel édifice du 155, boul. Charest Est.). Le projet a pris des années à se concrétiser, mais quelle fierté! À l’époque, on se vante d’avoir le siège social syndical le plus grand et le plus moderne du Canada.
Une déconfessionnalisation… lente
Kiosque intersyndical lors de l’exposition provinciale (Expo-Québec) de 1963; à noter qu’on parle encore de Conseil central des syndicats catholiques…
Si le conseil central et le secrétariat des syndicats catholiques volent de leurs propres ailes depuis la fin de la guerre, l’octroi de l’archevêché ayant pris fin avec la grève de l’Action catholique en 1945, les syndicats de Québec restent très attachés à leur caractère confessionnel. En 1959, le congrès du conseil central a même pris position contre la déconfessionnalisation de la centrale. Ce n’est qu’en 1965, soit cinq ans après que la CTCC soit devenue la CSN, que le conseil central enlèvera l’adjectif catholique de son nom pour redevenir le Conseil central des syndicats nationaux de Québec (CSN).
Condition féminine
L’apparition des militantes
Les travailleuses syndiquées se sont révélées aussi combatives que les travailleurs et elles ont mené de nombreuses grèves comme ici en 1952 à l’usine « Mastercraft » de Québec.
S’il y a toujours eu des travailleuses dans les syndicats de Québec, reste que le conseil central était un milieu typiquement masculin. Les militantes ont commencé à apparaître dans l’après-guerre, au fur et à mesure de leur pénétration du marché du travail.
La toute première déléguée à l’assemblée générale du conseil central semble avoir été Bernadette Lachance, présidente du Syndicat national catholique de l’industrie du corset de Québec au début des années 1940. La toute première élue au conseil exécutif du conseil central, en 1949, semble avoir été Juliette Laberge. Elle était présidente de la section féminine de l’Union protectrice des travailleurs de la chaussure. Il faudra attendre 1952 pour que le conseil central embauche une première femme, Berthe Renaud. En 1965, le tiers des membres du conseil central sont des femmes.
Une lutte oubliée
Les grands magasins de Québec
Si l’histoire a retenu, avec raison, la grève de Dupuis Frères à Montréal, on n’a pas souvenir d’un évènement similaire à Québec… et pourtant! La lutte des employés des grands magasins de Québec dans les années 1950 n’en fut pas moins épique et illustre bien les difficultés rencontrées par les membres du conseil central à l’époque.
Au début des années 1950, le Syndicat catholique des employés de magasins de Québec est présent sur une dizaine de sites du quartier Saint-Roch. Il s’est prévalu des dispositions de la loi sur l’extension des conventions collectives et bénéficie d’un décret de convention collective. Toutefois, la situation est loin d’être idéale, notamment parce que le décret est géré par un comité paritaire et qu’il n’y a pas de clause de sécurité syndicale. Bref, le syndicat n’est pas enraciné et n’a que peu de moyens de faire respecter la convention collective au quotidien.
En mars 1954, une assemblée de 800 personnes vote pour abolir le décret dans les grands magasins. La stratégie proposée par les conseillers techniques de la Fédération du commerce et les organisateurs du conseil central recommande de lancer une vaste campagne d’organisation pour demander à la Commission des relations ouvrières des accréditations dans chaque grand magasin et négocier des conventions collectives individuelles. La campagne d’organisation porte fruit et le syndicat se retrouve assez rapidement avec une vingtaine d’accréditations individuelles en poche.
La négociation de la première convention collective post-décret fut assez rocambolesque. En effet, après un premier arbitrage, six grands magasins de Saint-Roch ont donné le mandat à l’Association des marchands détaillants de négocier une convention collective générale en leur nom. Toutefois, à la dernière minute, la Compagnie Paquet retire son mandat et se déclare prête à négocier seule. Le 23 mars, les négociateurs du syndicat se rendent donc sur les lieux pour rencontrer la partie patronale. La table de négociation est à peine mise que 300 employés se mettent en grève et envahissent la salle de réunion en déclarant qu’ils ne retourneront pas travailler tant que la convention collective ne sera pas signée, ce qui fut fait quelques heures plus tard. Dès le lendemain, les autres grands magasins acceptaient eux aussi de signer une convention collective avec le syndicat.
L’histoire ne s’arrête toutefois pas là et connaît un épilogue juridique assez long. En effet, la convention collective signée comporte notamment l’introduction de la formule Rand. Or, à l’époque, si le monopole de représentation syndicale est reconnu et que les conventions collectives s’appliquent à tous les salariés, le membership syndical est encore libre. 254 employés sur 607 font donc savoir à la Compagnie Paquet qu’ils n’ont jamais autorisé le syndicat à prélever une cotisation sur leur paie. La partie patronale décide donc de suspendre les versements au syndicat. La conciliation échoue et le ministre du travail refuse de prendre position. La cause est donc portée devant les tribunaux. Un premier jugement en 1956 déclare la formule Rand illégale puisqu’il ne s’agit pas d’une condition de travail. La fédération et la CTCC décident de porter la cause en appel. Ce n’est finalement qu’en janvier 1959 que la Cour suprême du Canada juge la formule Rand légale.
Le syndicat tiendra le coup dans les grands magasins de Québec jusqu’à la fermeture du Syndicat de Québec dans les années 1980. Un seul des magasins syndiqués de l’époque est encore ouvert aujourd’hui, il s’agit de Laliberté. L’histoire ne dit pas quand la compagnie s’est débarrassée du syndicat. À l’heure actuelle, il ne reste plus de syndicat CSN dans les grands magasins de la région de Québec.
La Davie bouscule les habitudes
Les grévistes de la Davie posent pour le photographe du Travail en 1958.
En 1958, le Syndicat des travailleurs du chantier maritime de Lauzon bouscule les habitudes du conseil central en déclenchant une grève « hâtive ».
Traditionnellement, le conseil central voit la grève comme une arme de dernier recours. Or, les travailleurs de la Davie entendent bien user de leur rapport de force pendant qu’ils en ont un plutôt que d’attendre d’avoir épuisé tous les recours habituels. Ils profitent donc du fait que plusieurs navires sont à quelques semaines d’être lancés pour débrayer. La chose est tellement inusitée que le président du conseil central sent le besoin d’émettre une assez longue déclaration où il explique que les grévistes ont l’appui total du conseil central.
Après six semaines de grève, ils obtiennent enfin la parité avec les autres chantiers maritimes (ils étaient les moins bien payés au Canada). Le conseiller technique au dossier est un jeune homme qui marquera profondément la CSN, un certain Marcel Pepin.
Épilogue de la grève de l’amiante
En 1952, les syndicats de mineurs de Thetford Mines tournent la page sur la grève de l’amiante. La nouvelle convention collective prévoit l’abolition des postes des scabs embauchés en 1949 et le retour à leur poste de tous ceux qui avaient subi des préjudices pour fait de grève. À ceux qui prétendent que la grève fut un échec, la rédaction du Travail répond que, grâce à cette convention collective, les mineurs de la région ont le meilleur salaire de départ au Canada.
Vers la concertation
La peur du chômage
La chose la plus surprenante pour qui se plonge dans l’histoire du conseil central est de constater à quel point Québec était autrefois une ville pauvre. Il a fallu la révolution tranquille et, surtout, la syndicalisation massive des employé-es du secteur public pour que ça commence à changer.
Une ville pauvre
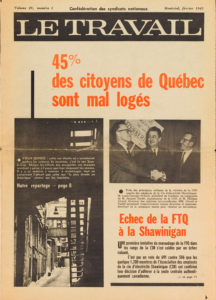 Quelques chiffres suffisent à illustrer la pauvreté relative de la ville de Québec à l’époque. En 1961, les salaires payés à Québec sont plus faibles qu’ailleurs : 68,05 $ par semaine contre 75,85 $ (moyenne québécoise) et 78,73 $ (moyenne canadienne). En parallèle, la ville est un vaste taudis où 45 % des gens sont mal logés.
Quelques chiffres suffisent à illustrer la pauvreté relative de la ville de Québec à l’époque. En 1961, les salaires payés à Québec sont plus faibles qu’ailleurs : 68,05 $ par semaine contre 75,85 $ (moyenne québécoise) et 78,73 $ (moyenne canadienne). En parallèle, la ville est un vaste taudis où 45 % des gens sont mal logés.
Les raisons sont multiples, mais la principale, selon Raymond Parent, le président du conseil central à l’époque, est le peu de grandes entreprises. Québec n’a pas d’attrait, pas de ressources naturelles, la plupart des industries sont à vocation locale. « Des petites entreprises dont le rendement est faible et où les salaires sont bas », comme le dit un rédacteur du Travail en 1963.
Le chômage, notamment saisonnier, est un réel problème dans la région de Québec. Il n’est pas rare qu’il atteigne 25 % de la population active. À un certain moment, il y a carrément autant de chômeurs dans la ville que de membres au conseil central. Ce n’est pas pour rien que le conseil central revendique et obtient, en 1944, la création d’un bureau d’attibution des prestations d’assurance chômage à Québec. C’est un sujet qui revient périodiquement durant toute la période.
Les débuts de la concertation
Il semble que la première expérience de concertation régionale remonte à 1956. En effet, cette année-là, le conseil central est à l’origine de la création d’un organisme de développement économique: le Comité conjoint d’étude des problèmes économiques de la région de Québec qui regroupe des intervenants syndicaux et patronaux ainsi que des élus municipaux. Entre autres « réalisations », la création d’un Bureau de l’industrie et du commerce du Québec métropolitain.
Parmi les propositions de cet organisme pour enrayer le chômage, en 1958, on retrouve les idées suivantes: retarder un peu l’entrée sur le marché du travail des jeunes travailleurs en rendant l’école obligatoire jusqu’à 16 ans et en donnant des bourses d’études à ceux qui voudraient les prolonger; changer le caractère fortement saisonnier de l’emploi dans la région; assurer le développement économique du Bas-Saint-Laurent pour freiner l’immigration économique; réduire la semaine de travail à 40 heures; réduire le double emploi; rendre le fleuve navigable à l’année; encourager l’achat local dans les industries; créer un fonds régional de développement économique; et réduire l’immigration aux possibilités d’embauche.
Action collective
Le comité logement du conseil central
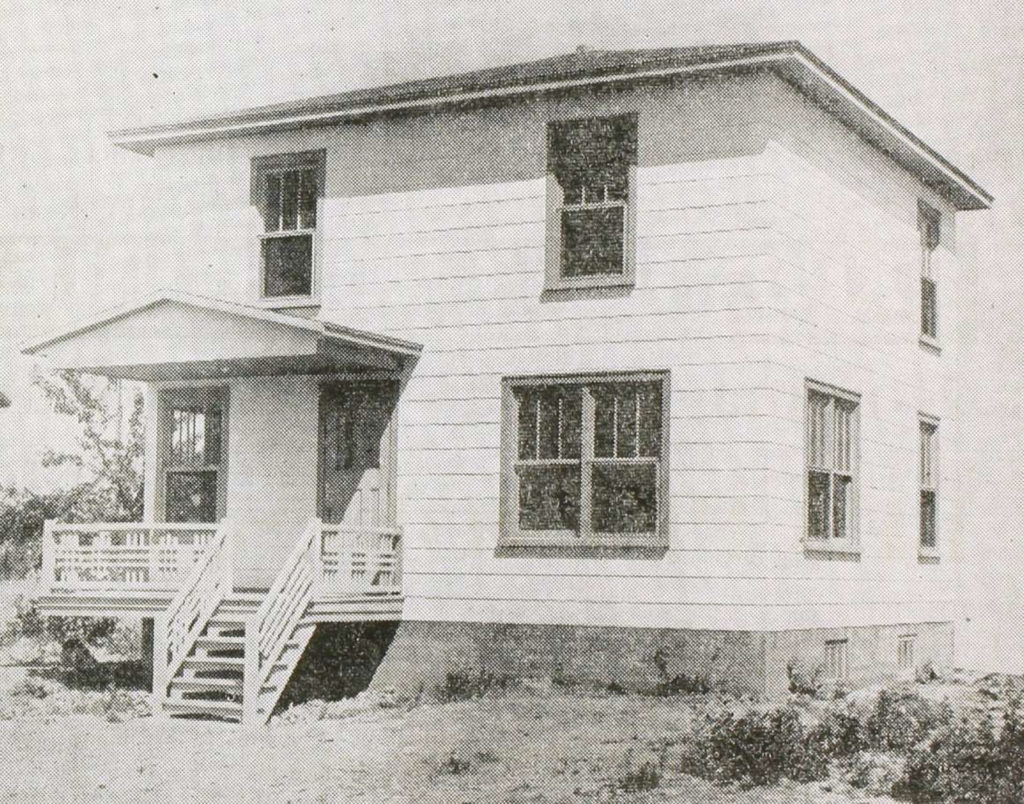
L’une des maisons construites par le conseil central.
Le conseil central s’est toujours intéressé à la question du logement, comme en témoignent des articles dans Le Travailleur dès 1922, mais un changement qualitatif s’opère dans les années 1950. En effet, les militantes et militants d’alors s’attaquent à la solution concrète du problème… en construisant littéralement des maisons pour les membres des syndicats catholiques.
Crise du logement
On s’en souvient peu, mais Québec a vécu une sévère crise du logement au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Au point où un bidonville de près de 1 000 personnes, dont 700 enfants, s’installe sur les plaines d’Abraham jusqu’en 1951. Au même moment, le gouvernement fédéral repense toute son intervention en matière d’habitation et abolit, entre autres, le contrôle des loyers établis pendant la guerre.
Les syndicats sont prompts à réagir et une grande campagne d’opposition est lancée à la fin de 1950. Le conseil central est le premier à organiser une assemblée populaire à Québec, au centre Durocher, au mois de janvier 1951. Jean Marchand, secrétaire général de la CTCC, et Joseph Parent, président du conseil central, s’insurgent contre l’abolition du contrôle des loyers et réclament des mesures spéciales contre l’inflation.
Rien n’y fait, malgré les protestations, le gouvernement va de l’avant avec ses projets. Évidemment, la question du logement ne disparaît pas pour autant comme par magie. L’année suivante, le congrès de la CTCC recommande à tous ses syndicats et en particulier aux conseils centraux, de « faire tout leur possible pour solutionner le problème du logement dans leur région (…) et de constituer à cette fin des comités logement ». Le mois suivant, le conseil central s’exécute et crée un comité logement composé de quatre membres.
Coopérative d’habitation
Le fait est qu’à l’époque, la majorité des ouvriers de la province sont locataires et que les dés sont pipés contre ceux qui voudraient devenir propriétaires. Selon un calcul de la CTCC, seulement 20 % des salarié-es de la province gagnent un salaire permettant de se qualifier pour un prêt hypothécaire.
À Québec, le comité logement se met au travail. On établit rapidement que les syndiqués de la ville ne peuvent pas payer plus de 37 $ par mois pour se loger, c’est donc de ce montant que l’on partira pour établir que la maison ne doit pas coûter plus de 6 000 $ en fin de compte. Les problèmes à surmonter sont multiples: spéculation, taxes municipales, mise initiale de 20 % à l’achat, inexpérience des acheteurs, etc.
Les solutions trouvées sont audacieuses. Pour casser la spéculation, le comité logement convainc le conseil central de faire sauter les intermédiaires, d’acheter lui-même les terrains et de se faire promoteur immobilier par l’intermédiaire d’une coopérative d’habitation. Afin de réduire les coûts au maximum, le conseil central décide de sortir de Québec et d’aller en banlieue ouest, à Sainte-Monique-des-Saules. On s’entend pour produire une maison modèle et, si ça marche, d’y aller pour en faire dix identiques.
En juin 1953, Adélard Mainguy, le président du comité logement, peut présenter la maison modèle à l’exécutif du conseil central et aux gérants des caisses populaires de la région de Québec. La présentation fut sans doute convaincante puisque durant les années qui ont suivi, la coopérative du conseil central a construit plus de 300 maisons ouvrières. L’expérience fut même reprise dans plusieurs centres ouvriers de la province par d’autres conseils centraux.
Le succès fut tel que le comité logement a dû mettre en place des critères de sélection basés sur les besoins afin de choisir les candidat-es. En échange, le comité leur imposait deux règles: pas de subdivision des maisons et pas de revente avant dix ans pour éviter la spéculation. Le financement temporaire revenait au conseil central et les prêts hypothécaires aux caisses populaires.
Le projet pilote n’a pas permis un réel décollage de la construction d’habitations ouvrières à Québec, entre autres parce que le conseil central n’a jamais pu résoudre le problème de la finance temporaire et que, faute de capitaux suffisants, les caisses populaires étaient très limitées dans le nombre de prêts hypothécaires qu’elles pouvaient consentir. Le problème de la création d’une « caisse habitation » a bien fait l’objet d’une journée d’étude au conseil central, mais on peut aisément comprendre que, sans renier le projet, les syndiqué-es hésitaient à immobiliser une trop grande proportion des fonds syndicaux dans des projets immobiliers.
C’est finalement l’intervention massive de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL), notamment par la garantie de prêt, ainsi que par l’augmentation générale des salaires pendant les trente glorieuses (1945-1975), qui est venue à bout du problème du logement (à tout le moins pour la classe ouvrière syndiquée).
==
Extrait du numéro de septembre 2018 du Réflexe



